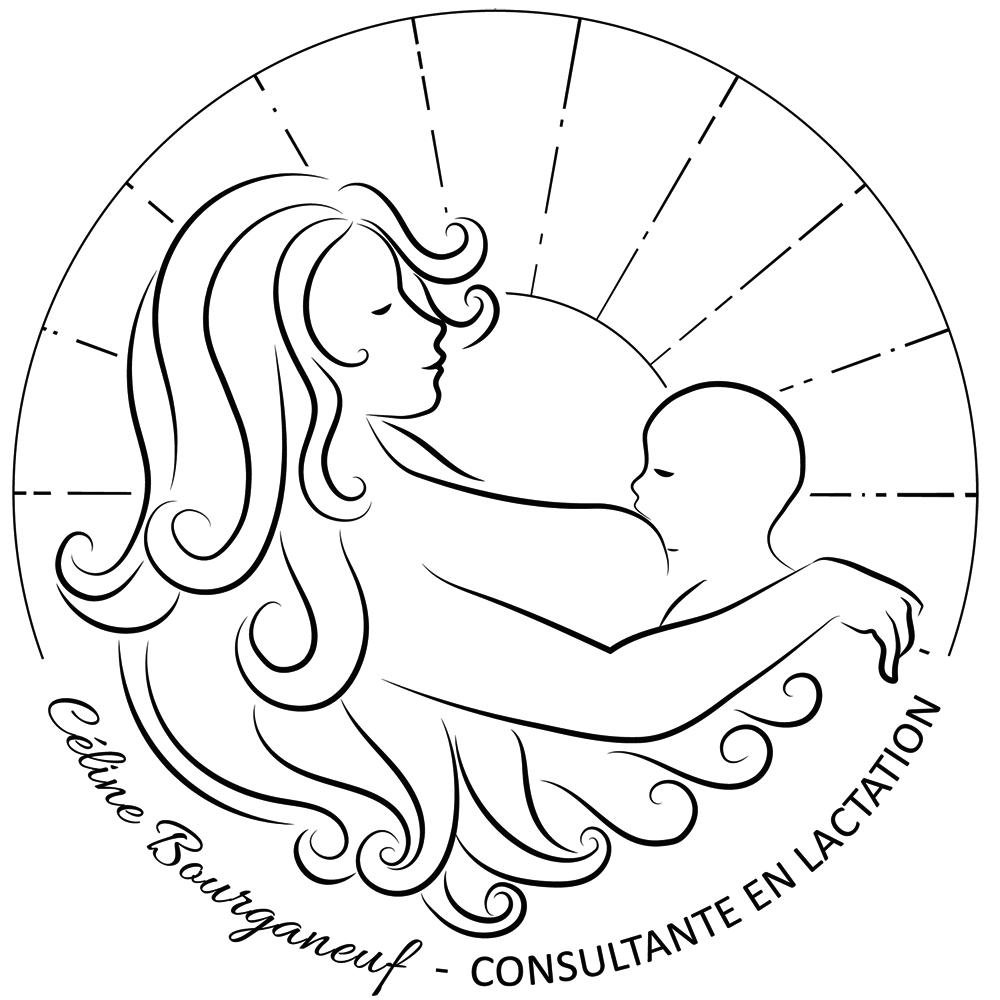Dépistage du cancer du sein : une perspective de Consultante en Lactation IBCLC
En tant que Consultante en Lactation IBCLC, je suis souvent amenée à discuter du dépistage du cancer du sein avec les femmes que j’accompagne. Ce sujet important, souvent source d’anxiété, mérite d’être abordé de manière claire et complète, en tenant compte des implications spécifiques à l’allaitement.
L’importance du dépistage
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Le dépistage régulier permet de détecter la maladie à un stade précoce, augmentant considérablement les chances de guérison. En France, le programme national de dépistage organisé concerne les femmes de 50 à 74 ans et propose une mammographie gratuite tous les deux ans.
Allaitement et dépistage
Il est possible de réaliser une mammographie pendant l’allaitement. L’examen n’a aucun effet sur le lait maternel et ne présente aucun risque pour le bébé. Cependant, il est important de :
Prévenir le radiologue que vous allaitez afin qu’il prenne les précautions nécessaires.
Vider vos seins juste avant la mammographie pour améliorer la qualité des images.
Appliquer un gel froid sur la zone après l’examen pour soulager d’éventuelles douleurs.
Recommandations pour les femmes allaitantes
Participez au programme national de dépistage organisé si vous êtes dans la tranche d’âge concernée.
Discutez avec votre médecin de vos antécédents familiaux et de vos facteurs de risque de cancer du sein.
Effectuez un examen clinique des seins régulièrement, par vous-même ou par un professionnel de santé.
Soyez attentive à tout changement de l’aspect ou de la texture de vos seins.
En conclusion
Le dépistage du cancer du sein est crucial pour la santé des femmes. L’allaitement ne doit pas être un obstacle à la réalisation de cet examen important. En suivant les recommandations et en discutant avec votre médecin, vous pouvez concilier allaitement et dépistage en toute sécurité.
Les différents cancers du sein et la chirurgie sénologique
Le cancer du sein est la tumeur maligne la plus fréquente chez la femme. En France, on estime qu’une femme sur huit sera diagnostiquée au cours de sa vie. Il existe différents types de cancers du sein, qui se distinguent par leur origine et leurs caractéristiques biologiques.
Les types de cancers du sein
Le carcinome canalaire infiltrant : C’est le type le plus fréquent, représentant environ 80% des cas. Il se développe à partir des cellules des canaux galactophores.
Le carcinome lobulaire infiltrant : Il représente environ 10% des cas. Il se développe à partir des cellules des lobules mammaires.
Le cancer inflammatoire du sein : C’est une forme rare et agressive de cancer du sein qui se caractérise par une rougeur, un gonflement et une chaleur du sein.
Le cancer du sein triple négatif : Ce type de cancer ne possède pas de récepteurs aux œstrogènes, à la progestérone ou à HER2, ce qui le rend plus difficile à traiter.
La chirurgie sénologique
La chirurgie sénologique est une spécialité chirurgicale qui se consacre au traitement des cancers du sein. Elle propose différentes interventions chirurgicales, dont les principales sont :
La tumorectomie : Il s’agit de l’ablation de la tumeur cancéreuse, en conservant le sein.
La mastectomie : Il s’agit de l’ablation complète du sein.
Le curage axillaire : Il s’agit de l’ablation des ganglions lymphatiques de l’aisselle, afin de rechercher la présence de cellules cancéreuses.
Le choix de l’intervention chirurgicale dépend de plusieurs facteurs, tels que le type de cancer du sein, son stade, la taille de la tumeur, l’âge de la patiente et ses préférences personnelles.
Les progrès en chirurgie sénologique
La chirurgie sénologique a connu des progrès importants ces dernières années. Les techniques chirurgicales sont de plus en plus précises et moins invasives, ce qui permet d’améliorer les résultats oncologiques et esthétiques.
L’importance d’une prise en charge multidisciplinaire
Le cancer du sein est une maladie complexe qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire. La chirurgie sénologique ne représente qu’une partie du traitement. Elle est souvent associée à d’autres traitements, tels que la chimiothérapie, la radiothérapie et l’hormonothérapie.
Le suivi après le traitement
Le suivi après le traitement est essentiel pour surveiller la survenue d’une rechute et détecter d’éventuels effets secondaires. Il est généralement réalisé par un gynécologue et/ou un oncologue.
Le cancer du sein est une maladie grave, mais les progrès de la médecine permettent d’en guérir un grand nombre de cas. La chirurgie sénologique joue un rôle important dans le traitement du cancer du sein et offre des chances de guérison importantes.
Allaitement maternel et prévention du cancer du sein : un atout précieux
En tant que consultante en lactation, j’accompagne chaque jour des femmes dans ce moment unique qu’est l’allaitement maternel. Au-delà des bienfaits pour le bébé, l’allaitement offre également à la mère une protection non négligeable contre le cancer du sein.
Un lien scientifiquement prouvé
De nombreuses études scientifiques ont établi un lien clair entre l’allaitement maternel et la réduction du risque de cancer du sein. Plus la durée d’allaitement est longue, plus la protection est importante. On estime qu’une femme qui allaite pendant 12 mois consécutifs diminue son risque de cancer du sein de 4 à 6%.
Les mécanismes en jeu
Plusieurs mécanismes biologiques expliqueraient ce lien protecteur. L’allaitement maternel permet :
Une régulation hormonale : l’allaitement modifie les niveaux d’œstrogènes et de progestérone, deux hormones qui peuvent stimuler la croissance des cellules cancéreuses.
Une différenciation des cellules du sein : l’allaitement favorise la maturation des cellules du sein, les rendant moins sensibles aux mutations cancéreuses.
Une élimination des toxines : l’allaitement permet d’éliminer des substances cancérigènes du corps de la mère.
Allaiter, un choix personnel, un atout santé
La décision d’allaiter est un choix personnel. Il est important de respecter les envies et les besoins de chaque femme. Cependant, il est important de connaître les bienfaits de l’allaitement, pour la santé du bébé et de la mère afin de faire un choix éclairé.
En tant que consultante en lactation, je suis là pour vous accompagner et vous aider à vivre l’allaitement sereinement. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez des conseils personnalisés.
En conclusion, l’allaitement maternel est un atout précieux pour la santé des femmes. En plus de ses nombreux bienfaits pour le bébé, il offre une protection significative contre le cancer du sein. Si vous envisagez d’allaiter, n’hésitez pas à vous faire accompagner par une consultante en lactation IBCLC pour maximiser vos chances de réussite.
Informations complémentaires :
Le site de la Leche League: https://www.lllfrance.org/ propose de nombreuses informations sur l’allaitement maternel, y compris ses bienfaits pour la santé.
Le site de la Fondation contre le Cancer: https://cancer.be/prevention/allaiter-reduit-le-risque-de-cancer/ propose des informations sur le lien entre l’allaitement maternel et la prévention du cancer du sein.
Informations complémentaires
Le site de l’Institut National du Cancer: https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein
Le site de la Ligue contre le cancer: [URL non valide supprimée]
N’oubliez pas que cet article est à titre informatif et ne remplace en aucun cas une consultation médicale.Institut National du Cancer (INCa): https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Les-points-cles
Le Collectif National des Centres de Lutte Contre
le Cancer (CLCC): https://www.clcc.ca/
Consultants en Lactation IBCLC France: https://iblce.org/french-2/
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations complémentaires.
Céline Bourganeuf
Crédit photo : @enviedeshoot